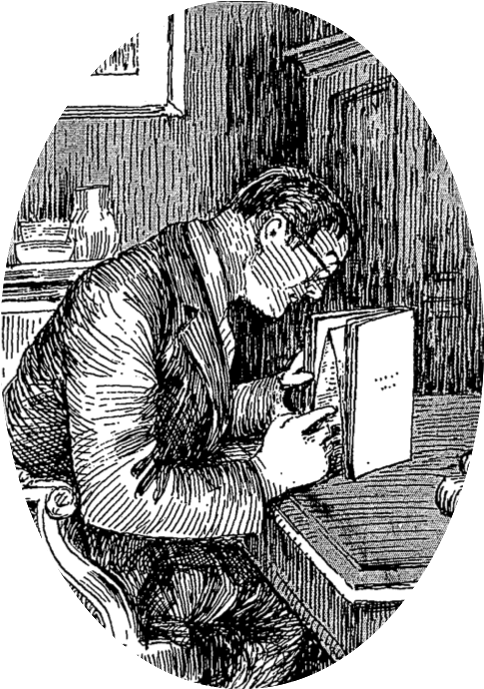
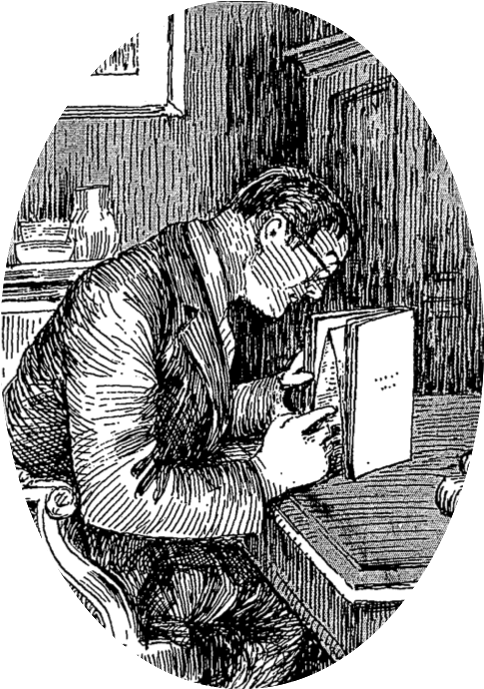
Ce site est consacré au deuxième des Documents pour servir de canevas, l’un des six contes que Raymond Roussel a insérés dans son ouvrage posthume Comment j’ai écrit certains de mes livres. Le lecteur qui craint que cette introduction ne déflore le sujet et ne lui gâte son plaisir est en droit de passer directement à la lecture de ce «document» [1] , puis à son analyse qui lui révélera que, derrière ce texte d’apparence limpide, s’en cache un autre [2] .
Il découvrira ou redécouvrira d’abord un récit à tiroirs qui tient en dix pages imprimées mais qui atteint le sixième niveau d’emboîtement — soit autant que le Manuscrit trouvé à Saragosse —, un récit qui nous conduit de Nantes au Mexique, du XIVe au XXe siècle. Une relecture minutieuse lui montrera ensuite que toutes sortes de jeux de mots, de jeux de formes, de références littéraires, historiques ou autres, font surgir des mots mêmes de ce «document» des significations nouvelles. L’ensemble constitue un véritable texte sous-jacent qui se superpose au texte apparent et qui va développer, préciser, compléter celui-ci — à moins qu’il ne le contredise.
Mais, objectera-t-on, ne s’agit-il pas là d’une n-ième tentative d’explicitation du «procédé» que Roussel nous a révélé dans Comment j’ai écrit certains de mes livres, tentative dont la seule originalité serait de porter sur un conte inexploré de ce point de vue ? Non. Une chose est de prétendre reconstituer la démarche de Roussel composant son récit, de deviner en quelque sorte le contenu de ses brouillons ; une autre chose est d’affirmer que ce récit est double, qu’il contient un texte caché, écrit par Roussel à notre intention, mais qui exige un réel effort de notre part pour être déchiffré. Cette distinction demande à être clarifiée, ce que je vais faire ci-dessous, bien que seule l’analyse mot à mot de l’œuvre de Roussel puisse emporter la conviction.
Les vingt premières pages de Comment j’ai écrit certains de mes livres (on les trouvera ici : http ://fr.wikisource.org/wiki/Auteur :Raymond_Roussel) sont principalement consacrées à la description du «procédé très spécial» que Roussel aurait utilisé pour composer ses ouvrages. Le procédé primitif, que Roussel nous explique à l’aide de nombreux exemples, est l’association de deux mots pris en deux sens différents :
«Je prenais le mot palmier et décidais de le considérer dans deux sens : le sens de gâteau et le sens d’arbre. Le considérant dans le sens de gâteau, je cherchais à la marier par la préposition à avec un autre mot susceptible lui-même d’être pris dans deux sens différents ; j’obtenais ainsi (et c’était là, je le répète, un grand et long travail) un palmier (gâteau) à restauration (restaurant où l’on sert des gâteaux) ; ce qui me donnait d’autre part un palmier (arbre) à restauration (sens de rétablissement d’une dynastie sur un trône). De là le palmier de la place des Trophées consacré à la restauration de la dynastie des Talou.»Si nous nous laissons prendre au ton pédagogique et quelque peu naïf de l’explication, nous allons croire Roussel. Nous devrons alors reconnaître que cet accouplement est bien lâche : le gâteau évoquerait plutôt un salon de thé ou une pâtisserie, la carte d’un restaurant pris au hasard fournirait des dizaines de plats bien mieux qualifiés que le palmier pour être reliés à restauration. L’association aurait certes pu traverser l’esprit de Roussel, mais elle n’a aucun caractère de nécessité. Nous n’aurions guère de chances de la retrouver par nous-mêmes ; le ferions-nous que nous n’y gagnerions rien en tant que lecteurs, le gâteau et le restaurant ne produisant aucun sens.
Et pourtant, si nous lisons soigneusement le chapitre X des Impressions d’Afrique, nous allons apprendre qu’un premier palmier fut brûlé par l’usurpateur Yaour V et que l’arbre que nous avons sous les yeux fut planté par Talou IV lors de la restauration. Ce palmier, certainement du genre phénix, put ainsi renaître de ses cendres. Pour nous conter les plantations successives, Roussel utilise les périphrases «graine de palmier» et «germe de palmier», mais cela ne doit pas nous tromper : la datte de la restauration a engendré l’arbre commémorant la date de la restauration.
Voilà qui est très différent du prétendu «grand et long travail» où l’un des sens de palmier, ou de restauration, serait resté dans les brouillons de Roussel et n’aurait été qu’une aide à la composition de son roman. Les associations que nous avons découvertes sont parfaitement rigoureuses et c’est précisément ce qui les rend lisibles. De plus, chacun des sens de datte-date et de phénix contribue à la signification de l’œuvre, même si les mots sont malicieusement cachés par Roussel. On ne trouve ni datte ni phénix dans le texte et il faut attendre le chapitre XX pour lire : «L’ouvrier peintre Toresse fut choisi pour composer un écriteau commémoratif rappelant la restauration déjà lointaine, dont la date coïncidait exactement avec la genèse de l’arbre.»
Sur la cinquantaine d’associations que Roussel nous donne en exemple, bien peu peuvent être considérées comme rigoureuses. Quant au «procédé évolué», sa mise en œuvre devient tellement vague que Roussel, qui jouissait pourtant d’une excellente mémoire, prétend n’avoir que des souvenirs imprécis. La définition en est pourtant claire :
«Le procédé évolua et je fus conduit à prendre une phrase quelconque, dont je tirais des images en la disloquant, un peu comme s’il se fût agi d’en extraire des dessins de rébus.»Un peu en effet : «les inconséquences», début du titre d’un ouvrage de Cherbuliez, se transformerait en «raisin qu’un Celte hante». Accepterait-on jamais cela dans un rébus ? Si Roussel avait véritablement utilisé ces dislocations approximatives, leur recherche serait pour nous impossible et, au fond, sans intérêt.
Ce que nous découvrirons en analysant le Deuxième Document, c’est un grand nombre de jeux verbaux — fondés notamment mais pas exclusivement sur la polysémie, l’homophonie et la dislocation — incomparablement plus rigoureux que leurs caricatures données en exemple. Ces jeux de mots s’associent entre eux, ainsi qu’à des jeux de formes, des jeux d’idées, des énigmes et des allusions de toutes sortes, pour former des ensembles cohérents et signifiants. L’humour de Roussel peut ainsi s’épanouir en tous sens, avec d’autant plus de force qu’il s’oppose au caractère sage et dépouillé du texte apparent.
Des références culturelles nombreuses et variées interviennent dans la résolution des énigmes mais la lecture des œuvres complètes de Victor Cherbuliez n’est heureusement pas nécessaire. Ce sont des auteurs plus célèbres que nous rencontrerons : Mallarmé, Stevenson, Melville, Conrad, Lamartine, Verlaine, Flaubert, Molière, Mirbeau, Stendhal, Verne, Corneille et d’autres. Il est un seul domaine dont Roussel exige de nous une connaissance approfondie, c’est notre langue ; les mots rares, techniques, archaïques ainsi que les acceptions inhabituelles de mots courants ne devront pas nous surprendre.
Michel Leiris rapporte que Roussel “considérait Bescherelle comme d’un niveau très supérieur à Larousse, disant à Mme Dufrène que c’était un peu comme Paquin et Callot par rapport à La Samaritaine [3] ”. Les confidences d’un auteur capable de rédiger un testament littéraire mensonger ne sont pas nécessairement fiables, et, en utilisant à trois reprises l’orthographe inhabituelle «terrein» dans l’Étoile au front, Roussel désigne clairement Littré pour son guide [4] . Nous verrons que des citations du Littré fournissent la clef de plusieurs énigmes du Deuxième Document.
Ce n’est pas seulement ce Document en forme de canevas qui est un texte à double entente. Ce sont aussi et surtout Impressions d’Afrique et Locus Solus. Dans un ouvrage qui sera, je l’espère, bientôt publié, j’élucide une part notable du texte sous-jacent aux Impressions d’Afrique. J’en extrais, pour la reproduire dans l’appendice, l’analyse de l’exhibition du ténor Cuijper, qui jette quelque lumière sur plusieurs mystères de notre Deuxième Document.
Les écrits de Roussel, en effet, ne sont pas indépendants et il n’est pas rare que tel passage, voire tel calembour, figurant dans l’une de ses œuvres, nous renvoie à une autre. Cela éclaire en particulier le rôle des Nouvelles Impressions d’Afrique, qui méritent mieux leur nom qu’il n’y paraît. Ces longues énumérations de courts fragments occupant tout ou partie de un, deux ou trois vers ont au moins une fonction identifiable : elles contiennent des allusions aux œuvres de Roussel, ou plus précisément à leur texte sous-jacent. Ces allusions — qui seront pour nous des indices ou des confirmations — portent principalement sur les Impressions d’Afrique mais aussi, nous le verrons, sur le Deuxième Document qui est pourtant publié ultérieurement. Les exemples mensongers de mise en œuvre du «procédé», dans Comment j’ai écrit certains de mes livres, fournissent également, de manière cachée, des indices précieux.
Il est temps de quitter ces quelques considérations théoriques pour passer à la lecture, puis à la relecture, du texte de Roussel.